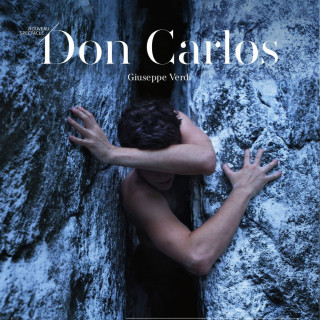
Synopsis
Don Carlos
À la mort de Charles Quint, son fils Philippe II, monte sur le trône d'Espagne et décide d'épouser Elisabeth, l'amante de son propre fils, Don Carlo, à qui elle est promise. Tandis que Don Carlo se lamente, son ami, le Marquis Rodrigo de Posa, lui promet son aide, réclamant en échange un soutient pour porter la cause du peuple de Flandre qui ploie sous le joug espagnol.
Montpellier 2024/2025
Création de l'opéra
Alors qu'il est universellement acclamé, Verdi accepte de composer pour la France, bien qu'il se plaigne de la durée des répétitions, de la qualité insuffisante des artistes et de la longueur des projets en ce pays. Malgré tout, Paris, capitale du Grand Opéra, apporte contrats lucratifs et gloire. Verdi doit donc composer avec les goûts parisiens, les scénographies imposantes : le Grand Opéra avec ses excès et ses ballets. Dès 1847, il accepte ainsi une commande bien payée de Paris et adapte son opéra italien Lombardi alla prima crociata en grand opéra français Jérusalem. Alors que, par la suite, Verdi compose des drames resserrés dans la veine de Luisa Miller (1849) et La Traviata (1853), il accepte de nouveau une commande française, Les Vêpres siciliennes en 1855, avec le librettiste du Grand Opéra, Eugène Scribe.
En 1865, Verdi revient à Paris pour la reprise des Vêpres et de Macbeth. L'italien est en plein triomphe international (jusqu'à Saint-Pétersbourg pour la création de La Force du destin en 1862). Les séjours parisiens sont toujours aussi amers, mais l'institution lyrique française parvient à signer un contrat avec le compositeur, pour une œuvre basée sur le Don Carlos de Schiller. Avec Friedrich von Schiller (1759-1805), Verdi choisit ainsi un poète et écrivain allemand romantique qui l'avait déjà inspiré en 1845 pour Jeanne d'Arc (d’après le drame La Pucelle d’Orléans de 1801), Les Brigands en 1847 (d’après le texte éponyme de 1782), et Luisa Miller en 1849 (Intrigue et amour, 1784). Schiller qui inspira également bien d'autres opéras, notamment Guillaume Tell de Rossini en 1829, Marie Stuart de Donizetti en 1835, Dimitri de Victorin de Joncières en 1876, La Pucelle d'Orléans de Tchaïkovski en 1881, La fiancée de Messine du tchèque Zdeněk Fibich en 1883, ou plus récemment Les Brigands et La jeune Fille de Domrémy de Giselher Klebe en 1957 et 1976.
Verdi rencontre des difficultés durant la composition de Don Carlos, s'étalant de 1865 à 1867. Les raisons sont esthétiques (adéquation au style français et à la prosodie de sa langue), mais aussi politiques : le contrat menace d'être rompu à cause du conflit entre la France et l'Italie (les français imposant leur armée en Italie pour protéger les états pontificaux).
Don Carlos est d'abord un opéra français, mais il est plus connu dans sa version italienne, Don Carlo (sans "s"), hormis en France et à Bruxelles, c'est dans la version italienne que l'opéra est créé à travers le monde. Si la version française a l'antériorité, elle est ensuite éclipsée par la version italienne qui rencontre le succès sur les scènes internationales. Don Carlos en français resurgira grâce à son premier enregistrement en 1985 (par Claudio Abbado, avec Domingo, Ricciarelli, Valentini, Terrani, Raimondi, Nucci, Ghiaurov, Murray et les musiciens de la Scala), puis en 1996 grâce à la mise en scène de Luc Bondy dirigée par Antonio Pappano à La Monnaie et au Châtelet, avant la production superlative de la Bastille en 2017 (Kaufmann, Yoncheva, Garanča, Abdrazakov, Tézier, par Warlikowski, direction Philippe Jordan).
La version originale de 1866 est composée pour l'Opéra de Paris, en français, en cinq actes et sans ballet. Le compositeur travaille de très près avec les librettistes Joseph Méry et Camille du Locle (qui doit terminer seul, après la mort de son collègue le 17 juin 1866) : il choisit des éléments du drame, exige que soient traduits des textes italiens qu'il rédige lui-même et contribue à écrire un texte en français dont la prosodie s'accorde avec sa musique. Pour les goûts parisiens, et sur demande de l'institution française, Verdi accepte d'ajouter un ballet pour se conformer au canon du Grand Opéra à la française dans la version (toujours Parisienne) du 11 mars 1867. L'opéra est ensuite adapté en italien, en quatre acte (sans l'acte I) et avec ballet dans la version de Milan (10 juin 1884), puis le cinquième acte est de nouveau rajouté, toujours en italien pour la version de Modène (29 décembre 1886).
Telles sont les quatre versions principales, mais il en existe bien d'autres de la main de Verdi, adaptées pour différentes scènes (sans parler des innombrables coupes et modifications effectuées ou acceptées par les maisons d'opéra pour plaire au public, aux chanteurs ou à l'orchestre). La version italienne a l'intérêt d'une musicalité typique de la langue de Verdi, mais la version française n'a rien à lui envier, c'est d'ailleurs pour le rythme de la langue française que Verdi a originellement composé la musique.
Accueil initial contrasté, avant triomphes
Don Carlos n'est pas particulièrement bien reçu. Comme souvent pour Verdi, les premiers interprètes ne sont pas au niveau, les répétitions n'ont pas été productives. En outre, le public parisien reproche à Verdi une trop grande proximité avec Wagner (les français réagissent de plus en plus contre l'art allemand à l'approche des conflits de 1870) et certains passages sont jugés choquants (notamment le fait de montrer la religion à travers la figure d'un inquisiteur). Verdi quitte la France. L'opéra n'est toutefois pas un échec, avec tout de même quarante représentations. D'autant que la réception par les mélomanes éclairés est excellente, prophétisant l'avenir radieux de l'opéra. Théophile Gautier apprécie notamment que Verdi conserve la beauté des mélodies et harmonies italianisantes d'un Donizetti, Hector Berlioz saluant son travail orchestral et la puissance dramatique. Don Carlo reste longtemps sous l'ombre du spectaculaire Aïda, délaissé jusqu'à son retour en grâce qui le propulse parmi les opéras les plus admirés du maître, notamment suite à l'interprétation de La Callas en 1954.











