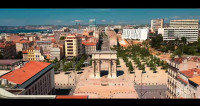Otello à Saint-Étienne, mortelle résurrection
Il y eut donc Don Quichotte de Massenet, début février 2020 (notre compte-rendu). Et puis un grand tunnel, à peine éclairé par l’esquisse d’une saison 20-21 stoppée avant même d’avoir pu vraiment commencer, à l’automne dernier. Mais voilà venu le temps du retour aux choses sérieuses, et donc aux choses lyriques, et c’est avec Otello de Verdi attendu de longue date que l’Opéra de Saint-Étienne reprend (en même temps qu’il clôt) sa saison. Un drame lyrique de Verdi ici servi par une production venue de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège et dont la mise en scène est précisément signée par celui qui, de 2007 jusqu’à son brutal décès en début d’année, fut le directeur de la maison liégeoise : Stefano Mazzonis di Pralafera.

Ici reprise par son ancien assistant Gianni Santucci, la scénographie du maître italien (créée il y a dix ans tout juste à Liège) présente une tournure visuelle d’un genre traditionaliste, mais qui reste globalement propre et efficace pour servir le propos. Les costumes tissés d’esthétisme de Fernand Ruiz se veulent fidèles à la temporalité du livret, le XVIème siècle vénitien : pourpoints, capes et pantalons flottants sont de rigueur chez les hommes, robes majestueuses sont de mise chez ces dames, et l’espace scénique se trouve seulement délimité par une colonnade et des voiles immenses servant, au besoin, à créer plusieurs petits espaces au cœur du plateau.

Un procédé loin d’être révolutionnaire, tout comme ces effets de lumière au lever de rideau incarnant l’orage et la tempête. Mais au moins l’intention scénique se comprend-elle clairement et ne choque guère, à défaut de surprendre (laissant plus sceptique sur cet aquarium dressé en avant de plateau pour représenter la mer livrée à la tempête, au début de l'acte I). Ainsi, le spectateur se laisse facilement transporter dans cette ambiance d’époque, et c’est la relative atonie de la direction d’acteurs qui interpelle davantage : les solistes paraissent souvent manquer soit de dynamisme, soit de naturel dans leur gestuelle. Comme dans ces entrées en scène effectuées sur des chariots roulants, qui semblent précisément inviter les protagonistes à une économie de moyens et de grands effets gestuels. Un constat de relative inertie qui semble cependant moindre, heureusement, à mesure que le funeste dénouement approche : dès l’acte III, l’implication scénique des solistes semble gagner en intensité pour se conclure dans les justes élans de fureur et de solennité attendus.

Gabrielle Philiponet, touchante Desdemona
Attendu, le plateau vocal l’est également, et il s’illustre. Desdemona est interprétée par Gabrielle Philiponet, verdienne définitivement accomplie qui, si elle reste relativement discrète lors des deux premiers actes (mais le livret le prévoit ainsi), brille de mille feux lors des deux derniers. De sa voix pleine au timbre clair et exquis, dont la projection ample et sonore tisse le fil d’une ligne de chant aussi homogène que riche de teintes variées, la jeune soprano se montre pleinement épanouie dans le rôle de la femme aimante mais victime de la jalousie de son époux. Investie dans l’incarnation des failles de son personnage, l’artiste se montre touchante et poignante dans sa cantilène implorante ("Piangea cantando nell'erma landa") puis dans l’Ave Maria qui annonce son sombre destin.

Pour sa prise de rôle, Nikolaï Schukoff est un Otello accompli, dont l’Esultate initial annonce la couleur : le timbre est chaud et vigoureux, la voix puissante et sonore, prenant même des contours volcaniques lors des passages où la jalousie mène le personnage à une fureur quasi incontrôlée, jusqu’à un repentir final lui aussi incarné avec une remarquable sensibilité scénique et vocale.

Le sombre Iago échoit à André Heyboer dont l’incarnation scénique remplit tous les critères du rôle : fourberie, manipulation, ténébrosité. Le tout porté par une voix pénétrante et ardemment timbrée, émise avec facilité, et dont les contours quasi démoniaques (y compris dans les emplois mezza voce) culminent dans le fameux "Credo in un Dio crudel". Un Iago si convaincant qu’il finit d’ailleurs par mourir lui aussi (ce que le livret ne prévoit pas), tué par l’Emilia impeccable de la mezzo Marie Gautrot, au timbre chaud, expressif et à l’amplitude vocale de belle tenue. Cassio trouve en Sébastien Droy un interprète qui parvient à se hisser à l’excellent niveau général, avec son timbre incisif et un ténor ample particulièrement épanoui dans l’aigu. Antoine Foulon est Lodovico, rôle qu’il défend ici avec une voix de baryton large et râblée, qui plus est projetée avec aisance. Le ténor Kaëlig Boché en Roderigo et la basse Geoffroy Buffière en Montano s’illustrent également, le premier avec son timbre clair et expressif par une émission emplie de délicatesse, le second avec une voix pleine au medium et aux graves bien assis. Enfin, en Araldo, Frédéric Foggieri use d’une voix de baryton-basse agréablement audible et solide en émission, qui ne passe pas inaperçue malgré de rares interventions.
Placé sous la direction dynamique et sensible de Giuseppe Grazioli, l’Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire livre une performance teintée des couleurs et des ambiances attendues (ici tempétueuse, là solennelle), même si l’effectif réduit à 42 musiciens, contexte sanitaire oblige, empêche le fuoco d’être encore plus ardent et expressif, notamment chez les cordes. Prestation irréprochable, enfin, pour le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire et la maîtrise d’enfants, tous deux aussi homogènes que sonores dans leurs interventions respectives. Ainsi, au baisser de rideau, et après la mort successive du trio principal, ce sont des applaudissements nourris qui viennent récompenser les artistes, applaudissements saluant aussi, sans doute, le temps d’une résurrection culturelle qui se faisait attendre depuis bien trop longtemps.