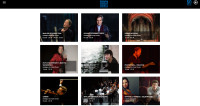Fidelio à Tourcoing : parabole politique et philosophique, mais aussi drame humain
Dans ce Fidelio programmé en concert par le Théâtre Municipal de Tourcoing, le drame, dans lequel s’affrontent des êtres de chair et de sang, l’emporte sur la fresque historico-politico-philosophique sans diminuer la portée du message profondément humaniste délivré par la musique de Beethoven. Tout concourt ici à lui donner des proportions humaines : les dimensions du théâtre (858 places, ce qui autorise une grande proximité, presque une complicité avec le plateau), le choix de l’orchestre (La Grande Écurie et la Chambre du Roy) et des solistes, pour la plupart familiers du répertoire baroque. Dans cette version sobrement mise en espace (par Jacky Lautem), les chanteurs occupent le plus souvent le devant de la scène, les climats de la pièce étant suggérés par quelques projections et un jeu de lumières adapté – les gestes des chanteurs-acteurs, leur physionomie, leur façon de dire le texte (les dialogues, réduits au strict minimum, sont dits en français) et la musique font le reste.
Véronique Gens aborde pour la première fois le personnage de Léonore/Fidelio, dont elle propose un portrait très personnel. Plus lyrique que dramatique, Véronique Gens n’en éclaire pas moins toutes les facettes du personnage, mais sa détermination face au danger et sa volonté de sauver Florestan participe plus d’une course éperdue dictée par l’amour que d’une force inébranlable lui permettant d’affronter Pizzaro d’ « homme » à homme. Elle délivre cependant avec assurance les redoutables sauts de tessiture de « Mich stärkt die Pflicht / Der treuen Gattenliebe! » (« Je dois ma force au devoir que m’inspire / La constance des liens de l’amour conjugal »), et son « Noch einen Laut – und du bist tot! » (« Encore un mot et tu es mort ») face à Pizarro a toute l’éloquence et la force requises. Elle fait entendre ailleurs dans le rôle une ligne de chant frémissante d’émotion, faisant du personnage une héroïne extrêmement touchante, plus qu’impressionnante.
Son Florestan est un habitué du rôle : Donald Litaker le chantait encore en mars dernier à Nantes. Le ténor américain, s’il chante régulièrement Wagner ou Strauss, compte aussi à son répertoire plusieurs rôles italiens et mozartiens, ce qui a sans doute contribué à préserver la clarté et la souplesse de son timbre, lui permettant de proposer un Florestan qui ne soit pas Heldentenor mais là encore un homme avec ses forces et ses faiblesses, en adéquation avec la lecture de l’œuvre proposée. Vocalement, Donald Litaker surmonte les difficultés du rôle (beau crescendo sur le difficile « Gott » - un sol aigu cueilli à froid ! – qui ouvre le récitatif de son air). Seuls les aigus des dernières mesures de son air bousculent un peu sa ligne de chant.

Le Pizarro d’Alain Buet est fort bien incarné physiquement et l’interprète distille son texte parlé avec art, donnant une image réellement inquiétante de Pizzaro. Il aurait fallu cependant un peu plus de puissance et de mordant pour que le portrait purement musical du personnage corresponde au portrait dramatique.
Luigi de Donato propose de Rocco un portrait très original et pleinement convaincant : doté d’un timbre soyeux et étonnamment clair pour une basse (ce qui n’empêche nullement le chanteur d’atteindre les notes les plus graves de la tessiture), Luigi de Donato arrache le personnage à une certaine tradition qui veut que Rocco n’ait d’autres préoccupations que matérielles, voire triviales. Ici, le personnage devient un père attaché à sa fille, à son bonheur et à celui de son gendre. Éloigné de toute forme de violence, il va jusqu’où son statut de simple geôlier lui permet d’aller : le refus de tuer lui-même Florestan. Les accents pleins d’une chaleureuse humanité dont Luigi de Donato pare son chant rendent justice à cette conception convaincante du personnage, que l’artiste a développée face au public lors d’un entretien à l’issue de la représentation).
L'auditoire retrouve avec grand plaisir Nicolas Rivenq dans le rôle de Don Fernando, certes épisodique mais que le chanteur défend avec un bel aplomb et un timbre quasi inaltéré, sauf dans le registre grave, un peu plus sourd. Jérémy Duffau, par son implication, par sa voix agréable et bien posée, parvient à faire de Jacquino mieux qu’une simple silhouette. Quant à Marie Perbost qui, il n’y a guère, était membre de l’Académie de l’Opéra de Paris (et qui nous en parlait, aussi bien que de cette production, en interview), elle fait entendre une voix puissante (parfois un peu trop : les autres chanteurs et l’orchestre s’en trouvent couverts pendant les ensembles), fruitée, excellemment conduite, et semble mettre un point d’honneur à donner chair au personnage secondaire de Marcelline.
Enfin, Nicolas Krüger dirige l’ensemble La Grande Écurie et la Chambre du Roy et le Chœur Régional Hauts-de-France avec une fougue, une précision, une implication qui font honneur à Jean-Claude Malgoire, lequel avait souhaité et programmé ce spectacle. Les deux ou trois attaques manquant de précision dans l’ouverture, les sonorités parfois un peu vertes des cordes, les quelques difficultés rencontrées par les cors pendant l’air de Léonore « Komm, Hoffnung! » (« Viens, espoir ! ») ne sont que broutilles face au dramatisme flamboyant insufflé à chaque page de la partition, y compris au premier acte, pourtant plutôt statique sur un plan dramatique. Un exemple parmi d’autres : le cri de jouissance sadique exprimé par Pizzaro dans son air : « Ha! welch ein Augenblick! » (« Ah, quel instant que celui-ci ! ») est précédé par un grondement sourd de l’orchestre, grondement qu’on imagine presque sous-terrain avant qu’il n’explose au jour, comme expulsé par des forces telluriques. Les cordes ponctuent ensuite les affirmations du gouverneur tels des couperets donnant un verdict sans appel, avant que leurs lignes tortueuses ne suggèrent les manigances d’un esprit vicieux en ourdissant un plan machiavélique.
Le public, extrêmement attentif pendant le concert, réserve aux artistes un accueil formidable à la fin du spectacle.